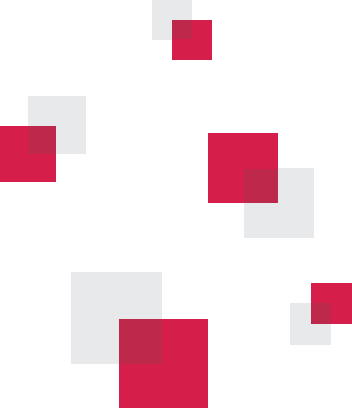En un coup d’œil
- Une étude commandée par l’Office fédéral des assurances sociales s’est penchée sur les systèmes de réadaptation professionnelle avec ou sans obligation légale d’emploi de la Suisse, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et des Pays-Bas.
- L’étude examine en particulier le rôle des partenaires sociaux dans la réadaptation professionnelle.
- Le succès de la réadaptation professionnelle ne semble pas spécifiquement lié à l’existence ou non d’une obligation légale d’employer du personnel atteint dans sa santé ; les éléments cruciaux dans ce processus sont plutôt la coopération entre les acteurs impliqués, ainsi que la mise à disposition et l’utilisation des mesures et des instruments de réadaptation.
À la demande de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), une étude a examiné différents modèles et mécanismes de réadaptation professionnelle des personnes atteintes dans leur santé (Geisen et al. 2025). Cette étude porte essentiellement sur une comparaison de six pays européens. Elle se penche aussi bien sur les systèmes de quotas que sur les modèles volontaires, et s’est intéressée de près au rôle des partenaires sociaux (associations d’employeurs et syndicats).
Parmi les pays qui ont instauré des quotas obligatoires en matière de réadaptation des personnes atteintes dans leur santé figurent la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. Ceux qui misent davantage sur le volontariat des employeurs sont la Suisse, la Grande-Bretagne et la Suède.
Suisse : le principe de volontariat domine
En Suisse, le système de réadaptation professionnelle repose en général sur le volontariat et les employeurs ne sont donc soumis à aucune obligation d’engager des personnes atteintes dans leur santé. Certains employeurs, comme l’administration fédérale, décident librement de se fixer des quotas. Le système suisse de la réadaptation professionnelle est caractérisé par sa décentralisation. Il est axé sur le travail en réseau et soutenu par différents acteurs. Les personnes atteintes dans leur santé et les employeurs sont au cœur de ce système.
Les assurances sociales, notamment l’assurance-invalidité (AI) et l’assurance-accidents, ainsi que les assurances privées d’indemnités journalières et la prévoyance professionnelle sont déterminantes pour la réadaptation professionnelle. En revanche, les partenaires sociaux n’assument qu’un rôle secondaire dans la mise en œuvre concrète de la réadaptation professionnelle. Néanmoins, ils sont décisifs pour la définition et l’élaboration du cadre légal et dans la conception des conventions collectives de travail.
Suède : le rôle clé de l’organisme des assurances sociales
La Suède ne connaît pas non plus d’obligation d’employer des personnes atteintes dans leur santé, bien que l’introduction d’une telle obligation fasse depuis longtemps l’objet de discussions. Ce pays dispose d’un système de réadaptation professionnelle centralisé et fortement structuré impliquant peu d’acteurs. Afin de promouvoir l’emploi des personnes atteintes dans leur santé, des prestations complètes de remplacement du salaire sont accordées aux employeurs, et des mesures d’aide à l’emploi sont mises en place. De plus, en Suède, les employeurs sont tenus par la loi de proposer à leurs employés des mesures et des activités de prévention de la santé et de réadaptation professionnelle.
Depuis 1992, les employeurs sont soutenus dans leurs démarches de réadaptation par l’institut suédois de sécurité sociale (SIA), qui est responsable de la coordination de ce processus. Les acteurs de la politique sociale de ce pays nordique critiquent l’absence de culture de réadaptation professionnelle dans l’assurance-maladie. De ce fait, les cas d’assurance se retrouveraient au premier plan et la réadaptation professionnelle ne serait traitée que comme un sujet marginal. Le manque d’activité des partenaires sociaux est en partie attribué à cette situation.
Grande-Bretagne : la discrimination prohibée
Jusqu’en 1995, la Grande-Bretagne était dotée d’une obligation légale d’employer des personnes atteintes dans leur santé. Cette disposition a ensuite été abolie au profit d’une réglementation générale interdisant la discrimination dans le processus de recrutement et les autres domaines de l’emploi. Les critiques formulées portent sur le fait que se concentrer uniquement sur le droit à la non-discrimination crée de nouveaux fardeaux pour les personnes concernées. Elles se retrouveraient ainsi livrées à elles-mêmes pour se défendre contre la discrimination, que ce soit au sein de l’entreprise ou devant les tribunaux.
Dans un tel système basé sur l’organisation individuelle, aucune aide fiable, axée sur des processus de maintien de l’emploi ou sur la réadaptation professionnelle, n’est assurée, que ce soit pour les personnes atteintes dans leur santé ou pour les employeurs. Cette lacune est actuellement en partie comblée par des organisations caritatives qui s’engagent en faveur des personnes atteintes dans leur santé. Les partenaires sociaux agissent au niveau politique, commandent des recherches sur des thèmes pertinents pour les personnes concernées et se chargent ponctuellement, au sein même des entreprises, des questions liées au maintien en emploi et à l’intégration.
France : un pilotage centralisé
En France, le système de réadaptation professionnelle repose sur une structure forte, avec une gestion centralisée, et présente une grande complexité. La réadaptation professionnelle y est mise en œuvre par des organismes spécialisés. Le pilotage est centralisé : des organisations nationales en assument la responsabilité globale, tandis que des organisations régionales se chargent concrètement de la mise en œuvre et de la collaboration avec les employeurs et les organismes chargés de la réadaptation professionnelle.
Depuis 1924, la France impose aux entreprises de vingt salariés ou plus d’employer des personnes atteintes dans leur santé en respectant un quota de 6 % de leur effectif total. Si ce taux n’est pas atteint, l’employeur doit s’acquitter d’une taxe affectée à l’amélioration de l’insertion professionnelle des personnes atteintes dans leur santé. Les partenaires sociaux assument un rôle actif dans ce système. Ils sont représentés au sein des organisations compétentes en matière de réadaptation professionnelle et influent activement sur la conception des offres de soutien destinées aux salariés. En outre, les syndicats peuvent s’engager directement en faveur des personnes atteintes dans leur santé sur leurs lieux de travail.
Allemagne : le règne de la complexité
En Allemagne également, la réadaptation professionnelle est soumise à un contrôle centralisé. Fortement structurée, elle comporte un grand nombre d’instruments de soutien qui contribuent à la complexité et l’opacité du système. Un quota légal en vigueur contraint les employeurs de vingt salariés ou plus à employer 5 % de personnes atteintes dans leur santé. S’il n’est pas respecté, les employeurs doivent s’acquitter d’une taxe compensatoire utilisée pour promouvoir l’emploi de ces personnes. En Allemagne, les partenaires sociaux s’engagent politiquement en faveur des personnes atteintes dans leur santé et des employeurs.
Mais en dépit de l’obligation légale en vigueur, leur intégration sur le marché du travail reste globalement marginale et l’emploi dans des structures spécialisées (ateliers) a fortement augmenté en Allemagne au cours des dernières décennies. Dans ce contexte, une augmentation de la taxe compensatoire, réclamée notamment par les syndicats, est en discussion.
Pays-Bas : une approche axée sur les réseaux
Le système de réadaptation professionnelle des Pays-Bas présente une structure en réseau impliquant un nombre limité d’acteurs. Dès 1947, une obligation légale imposait aux entreprises de réserver 2 % de leurs emplois à des personnes atteintes dans leur santé ; elle a ensuite été portée à 7 % entre 1987 et 1998. Cette réglementation a été fortement critiquée pour sa complexité et son manque d’efficacité.
En 2015, le quota d’emploi orienté sur les entreprises a finalement été remplacé par un autre quota corrélé au marché du travail. Il vise à l’horizon 2026 la création de 125 000 nouveaux emplois pour les personnes atteintes dans leur santé bénéficiant de l’aide sociale. Les employeurs et les employés sont en outre tenus par la loi de participer activement au processus de réadaptation professionnelle. Si cette obligation d’emploi n’est pas remplie d’ici 2026, les employeurs seront soumis à des sanctions, parmi lesquelles la réintroduction d’une obligation d’emploi obligeant chaque entreprise. Dans ce système, les partenaires sociaux agissent principalement au niveau politique sans être concrètement impliqués dans la mise en œuvre de la réadaptation professionnelle.
Rôles des partenaires sociaux
Les partenaires sociaux peuvent être amenés, suivant le contexte national, à exercer différentes fonctions dans la réadaptation. Tantôt ils s’emploient à affecter les ressources disponibles à la réadaptation professionnelle (fonction d’allocation) ; tantôt ils promeuvent des innovations sociales, telles que des projets pilotes, consacrées à la réadaptation professionnelle (fonction d’impulsion).
En outre, les partenaires sociaux sensibilisent la collectivité à la situation des personnes atteintes dans leur santé en mettant en lumière des exemples de bonnes pratiques et des stratégies de réadaptation professionnelle efficaces (fonction de multiplicateur). Enfin, ils peuvent œuvrer en faveur de la mise en place de conditions-cadres favorables en matière de droit social dans la réadaptation professionnelle (fonction politique) et assumer une part de responsabilité dans l’organisation et le contrôle des processus de réadaptation professionnelle (fonction procédurale).
Dans chaque pays à l’exception de la Suède, les partenaires sociaux assument une fonction politique en participant à l’élaboration du cadre légal. Partout à l’exception des Pays-Bas, ils participent également à la promotion d’innovations et au développement de modèles de projets. Cependant, seule la France implique les partenaires sociaux à l’attribution des ressources et aux processus de réadaptation. Enfin, tant en Allemagne qu’en France, en Suisse et en Grande-Bretagne, les partenaires sociaux jouent un rôle dans la sensibilisation en leur qualité de multiplicateurs.
Une évaluation isolée est exclue
La comparaison des systèmes complexes de réadaptation professionnelle montre que les quotas d’emploi obligatoire ne représentent qu’un facteur à disposition parmi d’autre. La même observation vaut aussi pour le quota d’emploi obligatoire basé sur le marché du travail inscrit dans la législation néerlandaise. Par conséquent, l’effet des modèles, qu’ils soient basés sur des quotas ou reposent sur une base volontaire, ne peut être évalué isolément. Ainsi, si l’on considère le déficit d’emploi (c’est-à-dire l’écart entre le taux d’activité de l’ensemble de la population active et celui des personnes atteintes dans leur santé), ce déficit atteint 16 % en Suisse (qui n’a pas fixé de quotas) et 19 % en France (qui en a fixés). En haut de l’échelle, on trouve l’Allemagne (qui a fixé des quotas) et le Royaume-Uni (qui n’en a pas fixés), avec des déficits d’emploi respectifs de 30 % et 28 % (OCDE 2022).
Si les facteurs contextuels (cf. Pawson et Tilley 1997) – tels que la situation économique, la politique sociale et la politique de l’emploi – s’avèrent déterminants pour la réadaptation professionnelle, il n’en demeure pas moins que l’importance accordée par la société à l’égalité de droit des personnes atteintes dans leur santé a également un impact sur leur participation au marché du travail.
Par ailleurs, différents mécanismes agissent sur le processus de réadaptation professionnelle dans des contextes nationaux spécifiques. Il s’agit notamment des aptitudes et des compétences des professionnels de la réadaptation ainsi que de la collaboration avec les employeurs et les autres acteurs importants. En outre, les mesures et instruments accessibles ainsi que la pertinence de leur utilisation ont une incidence sur le processus de réadaptation professionnelle : par exemple, des sanctions peuvent être prises en cas de non-respect d’une obligation d’emploi à laquelle doivent se soumettre des entreprises, ou de violation de l’interdiction de la discrimination.
Pour développer les systèmes mis en place, il est possible, d’une part, de s’appuyer sur les fonctions des partenaires sociaux déjà établies dans différents pays. D’autre part, l’introduction de nouvelles fonctions jusqu’ici inutilisées permettrait de renforcer la contribution des partenaires sociaux à la réadaptation professionnelle des personnes atteintes dans leur santé.
Bibliographie
Esping-Andersen, Gøsta (1990). The three worlds of welfare capitalism. Cambridge : Polity Press.
Geisen, Thomas et al. (2025) : Rolle der Sozialpartner bei der beruflichen Eingliederung von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen: Quotenmodelle und freiwillige Modelle. Studie im Auftrag des BSV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit. Rapport de recherche no 06/25.
OCDE (2022). Disability, Work and Inclusion: Mainstreaming in All Policies and Practices.
Pawson, Ray; Tilley, Nick (1997). Realistic Evaluation. London : SAGE.